Les prémices d’une nouvelle crise alimentaire ?
Septembre 2010
Pour le Rapporteur spécial des Nations unies pour le droit à l’alimentation Olivier De Schutter, les tensions actuelles au Sahel et au Mozambique révèlent les erreurs de stratégie agricole et les dysfonctionnements des marchés. Un diagnostic sans langue de bois.
L’actuelle crise au Sahel n’a pas constitué pour vous une surprise ?
O.D.S. : Non, elle était prévisible. On savait depuis octobre 2009 qu’en raison de la sécheresse les récoltes de mil, sorgho ou maïs avaient été mauvaises. Les revenus des petits agriculteurs ont été amputés. De même les éleveurs n’arrivaient plus à nourrir leur cheptel et ont été contraints de dilapider leur capital. Les gouvernements, eux, ont tardé à réagir. Au Niger, le président Mamadou Tandja a même délibérément fermé les yeux sur les risques de famine, avant d’être déposé par un putsch militaire le 18 février 2010.
Pourquoi une telle impréparation face aux aléas climatiques ?
Cette situation n’est pas propre au Sahel. Je reviens d’une mission en Syrie. Ce pays a connu quatre sécheresses successives depuis 2006 dont les effets auraient pu être atténués. D’une manière générale, il faut que les dirigeants se convainquent que les dérèglements climatiques sont appelés à se répéter et qu’il y ait une meilleure coordination des acteurs de terrain. Mais l’agriculture doit aussi évoluer : vulgarisation des techniques de collecte de l’eau de pluie, cultures moins gourmandes en eau ou capables de composer avec la salinisation des sols.
Au Tchad, le Programme alimentaire mondial (PAM) a dû, faute de ressources, limiter, son aide d’urgence aux familles ayant des enfants de moins de deux ans…
C’est une véritable honte pour la communauté internationale. Tout se passe comme si l’on attendait que l’incendie se déclare pour se mettre à la recherche de pompiers. J’ai proposé, il y a déjà plusieurs mois, que le PAM dispose d’une réserve stratégique qui lui permette de nourrir toutes les populations en détresse. J’ai également plaidé en faveur d’une réforme de la Convention sur l’aide alimentaire. L’aide ne doit pas être dépendante de la bonne volonté des donateurs internationaux, voire de leurs préoccupations politiques et commerciales.
Quelles sont les causes des émeutes contre la vie chère qui ont éclaté début septembre au Mozambique ?
Pendant des années, le FMI et la Banque mondiale ont poussé le Mozambique à se spécialiser dans les cultures d’exportation : noix de cajou ou canne à sucre. Du coup, le pays devait tabler sur les importations pour se nourrir. La taxe sur le blé importé a été réduite à 2,5 % et les paysans qui se consacraient aux cultures vivrières, incapables de rivaliser avec ces importations à bas prix, se sont découragés. Aujourd’hui, le Mozambique paie les conséquences de ce choix dangereux. Il est doublement vulnérable. Il s’expose d’abord aux variations des taux de change. Lors des douze derniers mois, le metical, monnaie mozambicaine, s’est dévalué de 43 % par rapport au rand sud-africain (pays d’où provient l’essentiel du blé du Mozambique, dont les importations globales de blé correspondent à environ 300 000 tonnes par an). Il est aussi dépendant des fluctuations des cours des denrées de base sur les marchés. Quand les cours grimpent, la facture explose. D’autant que les prix du fret, indexés sur ceux du pétrole, sont eux aussi orientés à la hausse.
Cette vulnérabilité risque de s’accroître avec les projets en vogue de production d’éthanol et de biodiesel…
En effet. Lors de sa réunion annuelle, le 25 avril 2010, la Banque mondiale a présenté une étude montrant que sur l’ensemble des projets d’investissements donnant lieu à des achats de terres dans les pays du Sud, 35 % étaient destinés à la production d’agrocarburants. C’est considérable.
Nous nous sommes battus pendant des années pour que les investisseurs s’intéressent au secteur agricole des pays en développement. Mais à présent qu’ils le font, ce n’est pas pour aider les petits paysans à moderniser leur exploitation, mais pour orienter les productions locales vers les marchés internationaux. Et même, si ces projets respectent quelques conditions sociales ou environnementales, le résultat, in fine, sera d’accroître la marginalisation des petits producteurs.
Les gouvernements africains n’ont-ils pas aussi leur part de responsabilité ? Ils s’étaient engagés en juin 2003 à dédier 10 % de leurs budgets nationaux au secteur agricole…
Seuls une douzaine de gouvernements africains sur une cinquantaine ont tenu leurs promesses. À cela, trois explications. Primo, les communautés rurales sont éloignées des centres de décision, là où les élites locales pactisent avec les investisseurs étrangers. Deuzio, les créanciers, qui privilégient le remboursement de la dette extérieure, poussent à l’essor des cultures d’exportation, seules capables de drainer des devises. Tertio, les cercles dirigeants, y compris africains, penchent en faveur de l’agro-industrie. C’est un préjugé culturel tenace et un contresens total. Seul un soutien persévérant octroyé à la petite agriculture familiale et paysanne du Sud est en mesure de relever le défi alimentaire. Je rappelle que les dernières crises alimentaires s’expliquaient par l’insuffisance des revenus des populations rurales beaucoup plus que par une pénurie de céréales.
Concernant l’augmentation des productions agricoles pour faire face à l’accroissement démographique, une double interrogation demeure : qui l’assurera principalement : les pays du Sud ou ceux du Nord ? Et sera-t-elle le fait d’une extension des surfaces cultivées ou d’une intensification de la production ? Selon les experts de la FAO, 25 à 30 % du surcroît de production viendra de l’extension des aires cultivées et 70 à 75 % de l’augmentation des rendements. Or, les gains de productivité sont surtout envisageables au sein de l’agriculture familiale des PED, notamment en Afrique subsaharienne. Il faut donc investir si l’on veut demain réussir à nourrir la planète.
En attendant, vous n’écartez pas la répétition d’une crise alimentaire du type de celle de 2008 ?
Non. Je crains même que nous en vivions les prémices. La situation est paradoxale. Au plan mondial, les stocks de céréales ont été reconstitués, après les bonnes récoltes de 2008, 2009 et une récolte satisfaisante en 2010. Cela n’empêche pas les marchés de rester très volatils. Il a suffi d’un avis de sécheresse en Russie, Ukraine et Kazakhstan pour que, de manière irrationnelle, les cours du blé flambent. La faute aux fonds d’investissement qui spéculent sur une augmentation continue du prix des produits agricoles. La spéculation n’est pas à l’origine de l’envolée des cours, mais elle l’accélère et l’aggrave. Concrètement, lorsque les opérateurs sont avertis de la canicule en Russie, ils achètent du blé à terme pour les trois ou six mois à venir, à des prix plus élevés que les cours du jour. La tentation des pays producteurs et des traders est alors de ne pas écouler leurs stocks dans l’attente d’une meilleure rémunération. Il existe donc une courroie de transmission, entre, d’une part, le monde des produits dérivés des marchés à terme et, d’autre part, le prix de la tonne de blé, de maïs ou de riz. Ce qui entretient indéniablement la volatilité des cours.
Je ne vois qu’une solution pour enrayer cette dérive. Il faut à la fois encourager les États à constituer des stocks alimentaires permettant de lisser les évolutions des prix. Et inciter les pays d’une même région à partager leurs informations sur le niveau de leurs réserves. Dans cette optique, si le Malawi connaît une mauvaise récolte, il peut compter sur les réserves d’un voisin mieux loti. Cette gestion des stocks et des informations à l’échelon régional jouerait le rôle d’une assurance mutuelle. Ce dispositif aurait un effet apaisant et empêcherait peut-être qu’une fièvre injustifiée s’empare des marchés.
Mais une telle initiative ne se mettra pas en place en quelques mois. Ce qui laisse largement le temps aux marchés de s’emballer et d’ouvrir la voie à une nouvelle crise alimentaire du type de celle de 2008. À cet égard, les prochaines semaines seront décisives.
Propos recueillis par Yves Hardy pour Faim Développement magazine du mois d’octobre 2010


J'ai 1 minute
Partagez et relayez nos informations et nos combats. S’informer, c’est déjà agir.
Je m'informe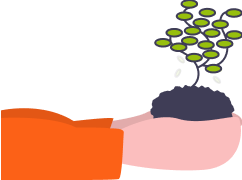
J’ai 5 minutes
Contribuez directement à nos actions de solidarité internationale grâce à un don.
Je donne
J’ai plus de temps
S'engager au CCFD-Terre Solidaire, c'est agir pour un monde plus juste ! Devenez bénévole.
Je m'engage










