Les dessous de l’économie verte
Vingt ans après le Sommet de la Terre de Rio, la nouvelle conférence onusienne Rio+20 prône, pour sauver la planète, les vertus d’une économie verte censée préserver la croissance et le profit des multinationales, tout en protégeant les écosystèmes. Mais, faute de remise en cause d’un modèle économique prédateur, notamment pour les pays du Sud, et en l’absence de régulation des multinationales, cette économie vise, en fait, à “marchandiser” la nature. Pourtant, des alternatives prometteuses, qui prennent en compte les intérêts des populations et la préservation des ressources, existent.
L’Ouganda, locomotive du bio en Afrique ! Le Programme des Nations unies pour l’Environnement (Pnue) a choisi de distinguer sa politique de conversion agricole pour en faire l’un des succès phares de l’« économie verte » dans les pays du Sud[[« Green economy success stories » (www.unep.org/greeneconomy)]]. En moins de deux décennies, plus de 200 000 paysans se sont mis à cultiver en bio sur près de 300 000 hectares. Ils émettent trois fois moins de CO2 qu’en agriculture conventionnelle, ils sont mieux rémunérés (par l’exportation) et moins exposés à la chimie agricole…
Voilà des pratiques « entraînant une amélioration du bien-être humain et de l’équité sociale tout en réduisant de manière significative les risques environnementaux et la pénurie de ressources » : la définition d’une « économie verte », selon un rapport du Pnue[[« Vers une économie verte », (www.unep.org/greeneconomy)]] devenu référence sur ce sujet central des débats préparatoires au Sommet Rio+20.
L’eau potable deviendrait un gigantesque marché planétaire
Autre monde : l’an dernier, une note stratégique du conglomérat financier Citigroup, dixième entreprise mondiale, livre la vision de l’économiste Willem Buiter sur le devenir de l’eau potable à l’horizon 2030 : un gigantesque marché planétaire, qui « ridiculisera par sa taille celui du pétrole et du gaz ». Des réseaux de canalisations, des flottes de tankers, des bourses de l’eau avec produits financiers dérivés. Et Buiter, s’il compte des détracteurs, rallie de puissants acteurs, tel Peter Brabeck, PDG de Nestlé.
Ces estomaquants projets de marchandisation de l’eau ne s’en revendiquent pas, mais apparaissent parfaitement compatibles, à lire la littérature dominante sur l’économie verte, de plus en plus abondante à mesure qu’approchait Rio+20. Pnue, Banque mondiale, OCDE, Union européenne, Organisation internationale du travail, think tanks, sont convaincus de tenir la solution qui se dérobe depuis vingt ans, quand le Sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 1992 consacrait le « développement durable » modèle de l’avenir. Il s’agissait alors de sortir de l’hégémonie d’un système économique qui creuse les inégalités et pille la planète, pour le mettre sur un pied d’égalité avec les politiques sociales et environnementales. Le concept est resté peu fructueux, faute de mode d’emploi. Aujourd’hui, nous expliquent de nombreux décideurs (souvent Occidentaux), la transition vers l’économie verte est la seule voie possible pour remettre en marche la machine vertueuse du développement durable.
L’argumentaire suppose d’accepter un pari tout à fait inédit : livrer la nature aux mécanismes du marché. L’économie verte entend gérer les écosystèmes, afin de leur faire produire des richesses et de la croissance tout en les préservant.
Vingt ans après le Sommet de la Terre de Rio, c’est le retour de l’économisme. Moins arrogant qu’auparavant peut-être, au vu des impasses dramatiques de l’économie « brune », dopée aux énergies fossiles et puisant dans les sols, les forêts ou les océans comme s’ils étaient intarissables. Mais la logique interne qui fonde l’économie verte ne change pas. Il s’agit de définir les « biens et services » rendus par les écosystèmes, et de leur donner un prix. Ils pourront ensuite être exploités pour produire de la richesse sonnante et trébuchante, mais rationnellement désormais – on ne tue pas la poule aux œufs d’or.
Exemple avec une mangrove. En économie brune, sa valeur a tendance à être négative : ces inextricables marais côtiers font souvent obstacle à l’installation d’un port de plaisance ou d’un hôtel de luxe. En économie verte, on mettra en avant le potentiel considérable de ces écosystèmes uniques, très riches en poissons et crustacés, barrières protectrices contre les houles tempétueuses, filtres à eau, sources d’aliments et de bois pour les villageois locaux. En 2012, le banquier indien Pavan Sukhdev remettait un rapport avant-gardiste[[« L’économie des écosystèmes et de la nature » (www.teebweb.org)]] : investir 45 milliards de dollars par an dans la gestion des seules aires protégées générerait dix fois plus de valeur, sous forme de « services » divers : pêche, reproduction du poisson et des crustacés, protection des côtes… Les mangroves deviendraient des placements beaucoup plus rentables que n’importe quel projet de bétonnage.
Forêts, bassins hydrographiques, littoraux, marais : les perspectives de l’économie verte ont de quoi attirer les investisseurs. Tout comme la maîtrise de certains cycles de matériaux, préoccupation majeure : comment poursuivre les affaires alors que se profile l’épuisement des mines de fer, de chrome, d’étain, de zinc, d’argent ? Ou que les émissions de gaz carbonique (CO2) menacent d’une augmentation des températures de 3,5°C pour la fin du siècle ?
Car l’économie verte n’entend pas renoncer à la sacro-sainte croissance. On n’y évoque la sobriété qu’aux marges, la société a sempiternellement des « besoins croissants ». On se propose d’atteindre la croissance permanente à prélèvement constant sur les ressources ! Moyennant une révolution des méthodes de production, des circuits de recyclage des métaux aux performances inouïes…
Les pays du Sud redoutent un avatar colonialiste
La maîtrise du cycle du CO2 – alors même que les émissions planétaires continuent de croître (plus 3,2 % en 2011) – se nourrit de la même logique. Alors que le sevrage des énergies fossiles est jugé hors d’atteinte avant longtemps, émerge un secteur industriel inquiétant : la géoingénierie, ou comment bricoler les équilibres planétaires pour absorber le CO2 (par stockage sous terre, prolifération du plancton, absorption chimique…) ou limiter le rayonnement solaire (masques en orbite, micro-particules en suspension). Quant aux marchés du CO2 et à leur financiarisation (émission de titres échangeables), chargés de faciliter la réduction des émissions, ils existent depuis près d’une décennie, avec les dérives que l’on connaît.
La protection de la biodiversité commence à tâter d’outils équivalents. Une fois admis le principe général de cette machine à dissoudre la nature dans l’économie, il n’y a pas de raison que lui échappent les semences, l’eau et pourquoi pas l’air un jour.
C’est dans l’Union européenne que l’on enregistre l’appétit le plus marqué pour l’économie verte. Les pays du Sud, eux, sont très dubitatifs, redoutant un avatar colonialiste : alors qu’ils abritent les écosystèmes les plus attrayants, les investissements proviendraient majoritairement de pays industrialisés.
Quoi qu’il en soit, l’économie verte est déjà en marche. Elle possède ses observatoires dédiés, tel Ecosystem Marketplace qui estime à plusieurs centaines de milliards de dollars les chiffres d’affaires réalisables d’ici à 2020 dans les secteurs du carbone, de l’eau, de la biodiversité et de l’agriculture.
Un loup déguisé en brebis
Mais, par quel miracle le système économique mondial actuel, s’il se contente de défricher de nouvelles aires de prospérité sans se réformer en profondeur, parviendrait-il cette fois-ci à œuvrer à l’équité sociale et à la protection de la nature tout en pérennisant ses profits ? s’interrogent des analystes critiques, tel le sociologue vénézuélien Edgardo Lander, qui dénonce la manœuvre du « loup déguisé en brebis ».
De grandes firmes semblent déjà avoir compris l’enjeu fondamental de la préservation des écosystèmes pour maintenir leurs marges, mais leurs initiatives en matière d’économie verte alimentent de sérieux doutes, et certaines ne se gênent pas pour inventer leurs propres normes.
Coca Cola définit ainsi sa « neutralité » en eau : d’une main, la multinationale protège des rivières dans le monde, de l’autre, elle épuise des nappes phréatiques en Inde, au grand dam des populations locales. Rio Tinto, géant de l’extraction de minerais, invente l’« impact positif net » sur la biodiversité : quand une mine sera épuisée, l’entreprise restaurera l’écosystème endommagé, et même – notion fumeuse –, au-delà de sa qualité initiale, expliquent ses plaquettes.
Par ailleurs, les promoteurs de l’économie verte ne font pas grand cas du volet social : comme dans la version « brune », l’amélioration des conditions de vie des populations, tout comme la protection des écosystèmes, seraient une retombée naturelle de la bonne santé des affaires. Idem pour la protection des écosystèmes, comme un axiome, dont il n’est pas difficile de montrer la grande fragilité.
Prenons une forêt. Et supposons son service « captation du CO2 » devenu suffisamment lucratif (en cas d’aggravation de la crise climatique) pour marginaliser, en valeur marchande, d’autres « fonctions » : conservation de la biodiversité, filtrage de l’eau, stabilisation des sols… Qu’adviendra-t-il ? Des investisseurs feront-ils pression pour raser la parcelle et la replanter en eucalyptus, monoculture à croissance rapide plus efficace pour stocker le CO2, et donc plus rémunératrice que l’entretien de l’écosystème initial ? Et ce n’est pas une élucubration : il y a quatre ans, les négociations internationales sur la création de nouveaux mécanismes de protection de forêts tropicales, dits Redd , ont validé, peu s’en faut, ce type de principe…
Il est notable que les quelques expériences mises en exergue par le Pnue pour leur caractère vertueux[[« Green economy success stories » (www.unep.org/greeneconomy).]] – développement d’énergies vertes au Kenya, en Chine…, financement d’infrastructures écologiques rurales en Inde, gestion communautaire des forêts au Népal…–, se développent sous contrôle des pouvoirs publics ou des populations locales, et non sous l’égide du libre marché.


J'ai 1 minute
Partagez et relayez nos informations et nos combats. S’informer, c’est déjà agir.
Je m'informe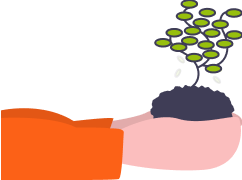
J’ai 5 minutes
Contribuez directement à nos actions de solidarité internationale grâce à un don.
Je donne
J’ai plus de temps
S'engager au CCFD-Terre Solidaire, c'est agir pour un monde plus juste ! Devenez bénévole.
Je m'engage











