Israël-Palestine
Vivre les uns sans les autres ?
Six ans après le début de l’Intifada, l’exaltation et le besoin d’en découdre ont cédé la place à une fatigue qui l’emporte sur l’impression que donnent de l’extérieur les séismes politiques des derniers mois. Le départ d’Ariel Sharon du Likoud – le parti de la droite israélienne – pour fonder Kadima (En avant) rejoint par le travailliste Shimon Peres ; la mort politique d’Ariel Sharon ; l’élection du syndicaliste séfarade, Amir Peretz, à la tête du parti travailliste, ré-ancré à gauche ; la victoire surprise du parti islamiste Hamas aux législatives palestiniennes du 25 janvier, puis celle, plus attendue de Kadima aux législatives israéliennes du 28 mars. Les cartes ont été considérablement redistribuées.
Un gouvernement réunissant un parti qualifié de « centriste » (Kadima) et le parti travailliste, est aux affaires en Israël. Dans le même temps, une formation islamiste, opposée au Processus d’Oslo et partisane du recours aux attaques contre les civils, a détrôné le Fatah, porteur historique de la cause nationale palestinienne, à la tête de l’Autorité palestinienne.
Ce chassé-croisé reflète pourtant une même aspiration : en finir avec les faux-semblants d’un processus de paix en déroute et régler les problèmes intérieurs.
Pour le Hamas, la stratégie conciliante suivie par le Fatah et l’Autorité palestinienne n’a rien apporté aux Palestiniens. Elle a affaibli leur position face à un pouvoir israélien qui n’a cessé d’imposer des faits accomplis sur le terrain. Ce désenchantement était déjà manifeste au début de l’Intifada, dont le message s’adressait autant à Yasser Arafat qu’à l’occupant. Le discrédit du processus a été renforcé par le fait qu’il a profité à une petite catégorie de privilégiés, percevant des commissions, remportant des marchés à titre personnel grâce à leurs relations israéliennes, détournant des fonds destinés à aider la population… Une corruption moins importante qu’en Égypte ou en Syrie, mais choquante dans une situation d’occupation.
Lutter contre la corruption, gérer sainement les services publics, signifier aux Israéliens qu’ils ne doivent plus compter sur la vaine conciliation de l’Autorité palestinienne étaient les principales significations de ce vote. Avec, en prime, un désir de retour à l’ordre : à la faveur du chaos sécuritaire, de la désorganisation des forces de l’ordre par la réoccupation des villes par l’armée israélienne, la délinquance et les groupes mafieux ont prospéré.
Pour une population palestinienne éprouvée par les bouclages, le chômage, les raids militaires, les destructions de maisons, les confiscations de terres, la violence des colons… le vote Hamas exprimait aussi une reconnaissance de la proximité des candidats du Hamas dont les actions sociales ont assis le crédit.
Israël
Le poids des enjeux sociaux
Dans une configuration toute différente, les résultats des élections israéliennes ont émis le même type de message. Les préoccupations sociales y ont joué un rôle essentiel. Malgré une croissance à plus de 5 %, la pauvreté touche désormais un Israélien sur cinq et 34 % des moins de dix-huit ans. Un taux record alors que les hauts salaires se sont envolés. Fondé sur des idéaux égalitaires, Israël est aujourd’hui marqué par une inégalité record : 74 % des Israéliens ne gagnent pas le salaire moyen. Les mères célibataires, les retraités ont été les victimes emblématiques de coupes impitoyables dans les budgets sociaux alors que ceux attribués aux colons et à leur protection ne cessaient de croître.
Le Likoud de Benyamin Netanyahu et sa politique ultra-libérale, largement responsable de cette évolution, a perdu beaucoup de ses soutiens dans les classes populaires, notamment parmi les Juifs séfarades. Mais il a aussi payé une rhétorique belliqueuse.
La proposition de Kadima qui permet de sortir de la confrontation sans fin avec les Palestiniens, explique son succès électoral. Sur les bases jetées par Ariel Sharon avec le retrait de Gaza, Ehud Olmert a promis de fixer unilatéralement les frontières d’Israël d’ici 2010, d’achever de construire le Mur qui sépare la Cisjordanie d’Israël, de rapatrier les colons qui se trouvent au-delà de cette frontière et de renforcer les blocs de colonies définitivement acquis. De laisser un État palestinien se former derrière la barrière de sécurité, devenue le tracé de la nouvelle frontière.
Un plan défini unilatéralement puisque, selon un principe récurrent de la politique israélienne depuis 2001, « il n’y a pas de partenaire pour la paix ». Puisq’aucun dirigeant palestinien ne serait capable d’arrêter les violences contre Israël, de renoncer au droit au retour des réfugiés, ni au principe du partage de Jérusalem. Puisque la haine accumulée est indépassable, que le rêve de relations pacifiques avec les voisins arabes est vain. Puisqu’il est trop coûteux pour Israël de contrôler des millions de Palestiniens.
L’arrivée au pouvoir du Hamas renforce la certitude qu’il faut divorcer de manière unilatérale. Cette perception est la nouvelle ossature du consensus israélien. Même si, à la demande de Washington et du parti travailliste, l’option d’une négociation avec le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, devra être explorée. À des conditions toutefois plus drastiques que celles qui ont déjà permis de réfuter Yasser Arafat et le même Mahmoud Abbas. On peut donc douter que cette perspective soit la plus probable.
Une alternative à un plan négocié ?
De manière très révélatrice, ce plan a été baptisé le plan de « convergence », une traduction de l’hébreu « hitkansout » (Se réunir entre soi). Et donc, a contrario, vivre sans les Palestiniens. Cette proposition permet de résoudre une équation toujours problématique pour Israël : comment demeurer une démocratie, tout en préservant le caractère juif de l’État ? L’expansion sans fin des colonies au cœur des zones de peuplement palestinien, le rêve du Grand Israël de la Méditerranée au Jourdain, obligeraient à incorporer toujours davantage la majorité arabe dans l’espace israélien. En se séparant selon un tracé le moins aberrant possible, en supprimant toute possibilité d’interaction avec les Palestiniens, on résout temporairement la contradiction.
Le plan de convergence offre-t-il une alternative durable à un règlement négocié ? Il consacre surtout des faits accomplis, en particulier l’intégration complète de Jérusalem-Est dans Israël et l’annexion de facto de tous les territoires situés à l’ouest du Mur, y compris les blocs de colonies. Il repousse sine die toute perspective d’accord sur les questions clés, dont celle des réfugiés. Autant de présupposés inacceptables pour les Palestiniens, même les plus modérés.
Cette orientation porte la marque d’une vision pessimiste qui inspirait la droite du mouvement sioniste dans l’entre-deux-guerres. Vladimir Jabotinski, principale figure du « révisionnisme » (il révisait les principes socialisants du sionisme) écrivait en 1923 : « Il est inutile d’espérer un accord entre nous et les Arabes qu’ils accepteraient de leur plein gré. […] Tous les sionistes modérés ont compris qu’il n’y avait aucun espoir d’obtenir l’accord des Arabes pour transformer cette Palestine en un État où les Juifs seraient en majorité. […] C’est pourquoi il faut nécessairement gérer notre œuvre de peuplement sans l’accord des Arabes palestiniens. »
« Une muraille de fer »
Il aboutissait à la conclusion que le projet sioniste ne pourrait progresser qu’à l’abri d’une « Muraille de fer ». Cette métaphore qui désignait l’armée s’est matérialisée aujourd’hui de manière saisissante dans le dispositif de séparation.
La séparation ne fait pas pour autant progresser l’idée de deux États, estime le géographe Oren Yiftachel, mais plutôt la réalité d’un « apartheid rampant ». Cet universitaire appartenant à une mouvance critique minoritaire, mais bien présente chez les intellectuels israéliens, travaille sur la notion d’ethnocratie (le pouvoir d’une ethnie). Israël en présente toutes les caractéristiques, avec ses « fondateurs », les Juifs européens, ashkénazes, à l’origine du projet sioniste et de la création d’Israël. Ses « immigrants », Juifs venus des pays arabes (plus récemment de Russie et d’Éthiopie), un apport démographique important pour le nouvel État dans les années 1950, ont été jugés indignes de prendre part à la décision politique. Ses « indigènes » enfin, les Palestiniens, par principe exclus du projet national juif mis en œuvre sur leur territoire.
Une structure totalement d’actualité. Aujourd’hui encore, il est difficile de remettre en question la position dominante des Ashkénazes dans les centres de décision politique. Comme en témoignent certaines réactions quasiment racistes à l’arrivée d’Amir Peretz, d’origine marocaine, à la tête du parti travailliste.
Discrimination
Arrivés dans les années 1950, du Maghreb, d’Irak, de Syrie… les Juifs séfarades ont été envoyés pour peupler les villes dites « de développement », dans le désert du Néguev. « Considérés comme des Arabes par les Ashkénazes, ils ont consacré toute leur énergie à se conformer à la vision dominante du bon Israélien », explique Henriette Dahan Kalev, professeur de science politique à l’Université de Beer Sheva, elle-même, d’origine marocaine. « Ils ont adopté les positions anti-palestiniennes les plus dures et sont allés chercher dans la colonisation des Territoires occupés un “certificat de vrai Israélien”, s’inscrivant ainsi dans le prolongement de l’histoire du sionisme ».
Environ 20 % des Israéliens sont palestiniens et jouissent en théorie des mêmes droits. Mais la discrimination emprunte des voies à peine dissimulées. L’illustration la plus récente est une loi validée par une récente décision de la Cour suprême qui prive de son droit à résider dans le pays un citoyen israélien qui épouserait un(e) habitant(e) des Territoires occupés. Motif officiel : la sécurité. Plus certainement, la préservation de la majorité démographique juive à l’intérieur du territoire israélien.
Des partis extrémistes proposent une solution plus franche : se débarrasser des villes palestiniennes d’Israël par un échange de territoires, ou carrément expulser les Palestiniens d’Israël.
Séparation unilatérale
Régler le problème des Territoires occupés par une séparation unilatérale pose des problèmes inattendus. Quand le Premier ministre Ehud Barak avait évoqué l’idée en 2000, les plus réservés avaient été les chefs d’entreprise, qui craignaient de perdre une main-d’œuvre soumise et bon marché. La question n’est pas nouvelle. Les immigrés juifs dans les années 1900-1920 ont voulu développer leurs implantations agricoles sans recourir à la main-d’œuvre arabe, pour éviter de reproduire un schéma colonial. Ils ont choisi, plutôt que des Européens, trop exigeants et moins productifs, des Juifs yéménites.
Mais s’indignait-t-on à l’époque, « Ce sont de véritables Arabes ! » ou encore « Ils ne comprennent rien au socialisme ». Ils n’ont donc pas été associés à la gestion des exploitations et sont restés longtemps misérables.
Intégration économique des territoires occupés
Après l’occupation de la Cisjordanie et de la bande de Gaza en 1967, l’option choisie était d’intégrer ces nouveaux territoires par l’économie, les échanges commerciaux et l’accès des Palestiniens au marché du travail. Plus de 120 000 Palestiniens se rendaient quotidiennement en Israël pour travailler. Une source de revenus qui a modifié la physionomie de leurs villages. « L’idée de rendre les Territoires s’est ainsi dissipée avec le temps et l’interpénétration des économies, explique Shir Hever, jeune économiste qui travaille pour l’Aic (le Centre d’information alternatif). Mais en même temps, les Palestiniens restaient soumis à une occupation militaire. »
Depuis le début de la deuxième Intifada, l’économie israélienne a appris à se passer des Palestiniens et emploie désormais des Thaïlandais, des Philippins, des Chinois…
« Le permis d’embaucher un travailleur étranger est accordé à l’employeur, qui peut donc le licencier, à la moindre rebuffade, à la moindre velléité d’organisation, sans perdre le bénéfice du permis », explique Shir Hever. Une pratique courante. « Comme l’immigré n’a pas gagné assez d’argent pour rentrer dans son pays, il reste, clandestinement, et accepte le travail au noir dans les pires conditions. C’est ainsi qu’on a remplacé la main-d’œuvre palestinienne ! »
L’inégalité reste donc au cœur du système, au moins autant que la confrontation de deux aspirations nationales. Dès lors, « accorder à des enclaves palestiniennes décorées avec des symboles d’État », une souveraineté limitée relève plus de « l’institutionnalisation de la hiérarchisation des droits que de la mise en place de deux États », avance Oren Yiftachel.
Le Mur permet de se séparer politiquement et économiquement de territoires palestiniens en crise, mais laisse toutes les réalités dérangeantes du conflit en suspens. Pour combien de temps ?
Thierry Brésillon
La Palestine enclavée
• Le tracé du Mur est désormais quasiment définitif et le quart nord-ouest jusqu’au sud de Jérusalem est déjà construit, à l’exception des passages destinés à intégrer les blocs de colonies (notamment Ariel) à Israël.
• Cinq points de passage seront bientôt achevés entre la Cisjordanie et Israël.
• Pour les paysans qui doivent se rendre dans leur champ de l’autre côté du Mur, la situation devient invivable, en dépit de ce qu’affirme le ministère de la Défense. Une seule autorisation est donnée pour chaque propriété et les permis sont difficiles à renouveler. Faire passer du carburant pour alimenter les pompes pour les puits est quasiment impossible.
• À l’intérieur de la Cisjordanie, la circulation entre les différentes enclaves est devenue problématique. La circulation de Jénine à Ramallah est bloquée par un checkpoint particulièrement hermétique, dont le contournement prend des heures.
Un réseau routier, réservé aux Israéliens, relie les colonies à Israël, instaurant un système de routes
« ethniques ».
• Jérusalem est totalement coupée de la Cisjordanie. La colonie de Maale Adumim coupe la Cisjordanie en deux.
Un tramway, dont le chantier est confié à des sociétés françaises, va renforcer l’intégration des colonies dans l’agglomération et couper de facto les quartiers palestiniens de l’ouest de la ville.
• La vallée du Jourdain reste sous contrôle militaire israélien.
• Les enclaves isolées les unes des autres constituent la base territoriale de l’État palestinien.


J'ai 1 minute
Partagez et relayez nos informations et nos combats. S’informer, c’est déjà agir.
Je m'informe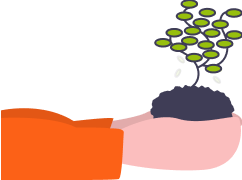
J’ai 5 minutes
Contribuez directement à nos actions de solidarité internationale grâce à un don.
Je donne
J’ai plus de temps
S'engager au CCFD-Terre Solidaire, c'est agir pour un monde plus juste ! Devenez bénévole.
Je m'engage












