En Amazonie, respecter la forêt fait vivre
Dans l’État du Para, au Brésil, la palme africaine destinée à produire des agrocarburants, menace la forêt. Un fléau auquel des petits paysans répondent en développant une agriculture respectueuse de l’environnement. Une alternative viable au concept ambigu « d’économie verte » qui fut au cœur des débats lors du dernier Sommet de la Terre, qui s’est tenu en juin à Rio de Janeiro.
Malgré la chaleur étouffante qui règne sous la serre, Candido Pereira arbore un large sourire. À l’aide d’un râteau, il étale sur une immense table des semis gris et marron, gros comme le poing. « Ces graines de muru-muru et d’andiroba représentent l’avenir de nos enfants et de la forêt amazonienne, clame le paysan de soixante-six ans. Ce sont des essences qui existent depuis la nuit des temps. Mais pendant des années, seuls les anciens les récoltaient pour les transformer en huiles capables de calmer la douleur, cicatriser les plaies ou encore éloigner les moustiques. »
Vendues depuis cinq ans à des laboratoires pharmaceutiques et cosmétiques, ces graines constituent désormais un complément de revenus substantiel à la culture de l’açaï, une espèce de palmier produisant un fruit qui ressemble à une grosse myrtille, élément central de la nourriture des populations amazoniennes. Mais elles ont aussi motivé la création de l’association des petits producteurs de Javari, regroupant une cinquantaine de familles.
Objectif ? « Vivre dignement de la terre tout en respectant la forêt, explique Candido Pereira. Mais surtout, nous unir pour lutter ensemble contre l’avancée de la monoculture de la palme africaine qui menace la région. »
Bienvenue à Moju, une commune de 55 000 habitants située dans le bassin hydrographique du Baixo Tocantins, à une centaine de kilomètres de Belem, la capitale de l’État du Para, en plein cœur de l’Amazonie brésilienne. Composée pour une bonne moitié de terres marécageuses, cette région vit, depuis le milieu du XIXème siècle, de la pêche et de l’agriculture familiale, une activité qui occupait, jusque dans les années 2000, plus de 80 % des terres. « Le Baixo Tocantins a toujours été l’un des principaux vergers du Brésil, explique Elias Kempner, président du Syndicat des travailleurs et travailleuses ruraux du Brésil (STTR). Grâce d’abord à l’açaï, qui représente les trois quarts de la production de l’État du Para [et 82 % de la production nationale], mais aussi grâce à d’autres produits comme la banane, le cacao et le cupuaçu. Sans compter le manioc, le poivre et de multiples oléagineux (miriti, andiroba…). » Des cultures essentiellement développées par des entreprises familiales, dont la taille moyenne dépasse rarement les 25 hectares mais sur lesquelles travaillent tout de même près de 95 % de la population active de la région.
Le combat des coopératives contre monoculture
Cette configuration a pourtant commencé à changer au milieu des années 1990, avec le développement des monocultures d’açaï. « L’idée, soutenue par le gouvernement de l’époque [celui de Fernando Henrique Cardoso, président de 1995 à 2002, ndlr], a consisté à ne laisser sur pied que les arbres qui rapportaient de l’argent, c’est-à-dire essentiellement l’açaï », rappelle Loureno Bezerra Lima, technicien agricole au sein de la Fédération des organismes pour l’assistance sociale et éducative (Fase), un partenaire du CCFD-Terre Solidaire, chargé d’accompagner le développement local de l’agriculture familiale.
Dès 2003, sous l’impulsion du gouvernement Lula, cette logique agroindustrielle va même se renforcer avec le développement de la monoculture de la palme africaine, destinée à la fabrication d’agrocarburants. « En l’espace de six ans, au moins un tiers de la région a changé de visage, précise Loureno Bezerra Lima, que ce soit à travers l’achat de terres ou via des baux de longue durée, la palme africaine a pris une ampleur considérable, comparable à celle du soja dans d’autres parties de l’Amazonie. » Avec, à la clé, les fléaux classiques liés à cette activité : exode rural, dégradation de l’environnement et disparition progressive des productions locales.
Cette période verra la naissance de la Coopérative des producteurs de fruits d’Abaetetuba (Cofruta), dont le siège est situé dans la principale ville du Baixo Tocantins. « Depuis 1992, nous avions déjà créé, avec une quarantaine de familles, l’association de développement des mini et petits agriculteurs d’Abaetetuba (Adempa), pour réagir face à l’industrialisation de la culture de l’açaï, en mutualisant notre force de travail » indique Raimundo Brito de Abreu, l’un de ses fondateurs.
La carte de la qualité et de la valeur ajoutée
Mais le combat s’est avéré toujours plus inégal face à une concurrence ayant largement recours à la mécanisation pour l’épandage et la récolte. Pas du genre à renoncer, les membres de l’Adempa ont alors choisi de jouer à la fois la carte de la qualité et de la valeur ajoutée, en créant leur coopérative, en 2002. « L’idée a consisté à conquérir un marché de produits certifiés bio, à créer une petite unité de production de pulpe de fruits – un marché très développé au Brésil – et à diversifier la production en insistant, plus que jamais, sur la dimension de production respectueuse de l’environnement », indique Raimundo Brito de Abreu.
Un pari plutôt réussi si l’on s’en tient aux chiffres annoncés par celui-ci. « Le revenu mensuel de chacun des 136 sociétaires de la Cofruta varie aujourd’hui entre 1 500 et 2 000 reais par mois [entre 640 et 850 euros]. » Des émoluments très confortables pour le pays.
Mais l’essentiel est sans doute ailleurs. Car « Cofruta démontre qu’il existe une véritable alternative, économiquement viable et respectueuse de la biodiversité, au concept « d’économie verte » tel que nous l’imposent les dirigeants politiques et les grandes entreprises, notamment lors du prochain Sommet de la Terre de Rio », se réjouit Loureno Bezerra Lima de la Fase. « Cette coopérative prouve aussi que le modèle d’agriculture familiale et raisonnée, s’il est structuré, est même largement plus rémunérateur pour les travailleurs du monde rural que l’agroindustrie », renchérit Elias Kempner. La preuve ? « Aujourd’hui, les entreprises qui cherchent à développer l’activité de la palme africaine dans le Baixo Tocantins offrent, dans le cas d’une location de terre, l’équivalent d’un salaire mensuel minimum (280 euros environ) sur une période de cinq ans. »
Pour convaincre les agriculteurs qu’il s’agit d’une bonne affaire, les entreprises leur proposent de verser cet argent en une seule fois, ce qui représente une somme astronomique pour des personnes modestes.
Un marché de dupes
« Mais elles se gardent bien d’évoquer les terribles dégradations des sols, et ce, pour des années, conséquence de l’usage de pesticides et autres désherbants hautement toxiques. » Une mise en garde qui est au cœur du travail d’information et de sensibilisation développé dans la région depuis des années par Loureno Bezerra Lima.
Pour cela, il peut compter sur les témoignages glanés par Candido Pereira de l’association Javari. « Je connais de nombreux petits agriculteurs qui se mordent les doigts d’avoir vendu ou loué leurs terres pour y produire de la palme africaine, assure-t-il. Une fois qu’ils ont dépensé en ville l’argent qu’ils avaient touché, ils reviennent et mendient pour un peu de travail sur la terre d’un autre. » Pour Loureno Bezerra Lima, la réponse la plus efficace reste cependant la création de projets structurés d’agriculture familiale. En commençant par l’association Javari. « L’objectif est désormais de les accompagner pour qu’ils puissent créer leur propre coopérative », assure-t-il.
Candido Pereira est, lui aussi, certain qu’ils sont dans le vrai : « Nous autres, petits agriculteurs, on prouve tous les jours qu’on est non seulement capables de lutter contre ceux qui veulent détruire la forêt, mais que si on la préserve et la respecte, la nature peut nourrir des millions d’êtres humains. »


J'ai 1 minute
Partagez et relayez nos informations et nos combats. S’informer, c’est déjà agir.
Je m'informe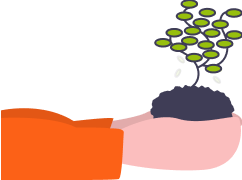
J’ai 5 minutes
Contribuez directement à nos actions de solidarité internationale grâce à un don.
Je donne
J’ai plus de temps
S'engager au CCFD-Terre Solidaire, c'est agir pour un monde plus juste ! Devenez bénévole.
Je m'engage











