En l’absence de règles adaptées
Les trente dernières années ont transformé le visage des grandes entreprises. La concentration en a vu certaines devenir des mastodontes, d’autres disparaître. Hier l’ancrage territorial était fort, les entreprises trouvant dans un pays l’essentiel de leurs actionnaires, de leur main-d’œuvre et de leurs consommateurs. Elles se composent aujourd’hui de plusieurs centaines de filiales, chacune avec ses multiples fournisseurs et sous-traitants. Présentes dans le monde entier, elles font souvent le gros de leur chiffre d’affaires loin du siège, non sans questionner leur capacité à s’ouvrir à des salariés des quatre coins du monde. Dans cette course en avant, les besoins de financement se sont accrus et, souvent, portés vers la bourse.
L’actionnariat des grands groupes s’est diversifié et surtout, désinvesti du projet (l’actionnariat salarié pouvant faire exception). En vingt ans, la durée de détention moyenne des actions est passée de deux ans à quelques jours, alors qu’un investissement n’est réellement efficace, le plus souvent, qu’au bout de cinq ans. L’actionnaire veut dorénavant connaître en temps réel la valeur de l’entreprise. Du point de vue comptable, l’entreprise devient un ensemble d’actifs financiers, dont on pourra se séparer si la performance ne satisfait pas. Les fonctions les mieux payées au sein de l’entreprise ne sont plus les ingénieurs, ni les « créatifs » du marketing, mais les financiers.
L’étendue des responsabilités
La portée de l’activité des multinationales s’est considérablement accrue, mais leur périmètre exact reste mal défini, tout comme l’étendue de leurs responsabilités.
Or, à lire les rapports extra-financiers des entreprises françaises, souvent celles-ci semblent peu attentives à l’impact sociétal et environnemental de leurs activités dans leur chaîne de valeur. Dès lors, comment évaluer si la contribution des entreprises au développement via l’emploi, l’investissement, la formation ou le transfert de technologie n’est pas inférieure aux coûts assumés par les sociétés humaines où elles s’implantent ?
Le cap de l’entreprise reste fixé par un petit nombre, le débat aux échelons inférieurs étant rare. La rémunération de certains dirigeants est indexée sur la valeur de l’action. Ainsi prévaut l’intérêt d’actionnaires cherchant le plus souvent la rentabilité à court terme sur celui des salariés, des clients, ou des territoires où la richesse est produite. Le paiement de l’impôt, le respect de l’environnement, les droits des travailleurs en pâtissent. Même les dirigeants d’entreprise soucieux du bien commun sont soumis à la course au rendement. Le pape François y voit « la dictature de l’économie sans visage » (EG 55).
Dès lors, à qui attribuer la responsabilité en cas de violations des droits ? L’Église ne tranche pas, mais invite à examiner les responsabilités de l’employeur direct et de « l’employeur indirect [qui] détermine substantiellement l’un ou l’autre aspect du rapport de travail et conditionne ainsi le comportement de l’employeur direct lorsque ce dernier détermine concrètement le contrat et les rapports de travail » (Laborem exercens, LE 17).
Juridiquement, les multinationales n’existent pas en tant que groupes. Elles sont un ensemble d’entités séparées, chacune se voyant appliquer le droit de son pays d’implantation. Une filiale étrangère commet une infraction, le siège n’a pas à en répondre (du moins devant le juge). De même quand le sous-traitant viole le droit du travail pour satisfaire la cadence et les bas prix imposés par une multinationale. Au point que certains groupes entretiennent l’opacité autour de leur structuration (parfois plus de sept échelons de filialisation ou de sous-traitance) pour diluer la responsabilité. Si des discussions avancent, le droit ne s’est pas encore adapté à l’échelle qui est désormais celle des grandes entreprises.
Et les États ?
Après avoir mis en concurrence les entreprises du monde entier, les États se retrouvent à leur tour en concurrence. Les multinationales choisissent de s’implanter là où le meilleur accueil leur sera réservé. Elles savent manier le chantage à l’emploi et, au besoin, produire l’expertise nécessaire pour convaincre. On compterait à Bruxelles 30 000 lobbyistes (presque autant que d’agents de la Commission européenne). Dans certains secteurs, le recours à la corruption est généralisé.
Peu à peu, la puissance publique ajuste ses lois pour satisfaire les investisseurs privés. La législation la moins contraignante en matière sociale, environnementale ou fiscale est appelée « favorable ». Les « zones économiques spéciales » (79 en 1975 ; 3 500 en 2006 [[Cf. Rapport « L’économie déboussolée : multinationales, paradis fiscaux et captation des richesses », publié en 2010 par le CCFD-Terre Solidaire. ]] ) en sont la pointe avancée. Au-delà des aménagements promus par la Banque mondiale (classement Doing Business), les entreprises n’hésitent pas à demander aux États hôtes des clauses de stabilité visant à geler le droit en vigueur pour se protéger de toute évolution !
Questions pour un partage :
• Comment évaluer les bénéfices sociaux d’une activité économique au regard de ses conséquences négatives ?
• Les États sont-ils condamnés à l’impuissance devant les multinationales ? Quel pourrait être leur rôle ?


J'ai 1 minute
Partagez et relayez nos informations et nos combats. S’informer, c’est déjà agir.
Je m'informe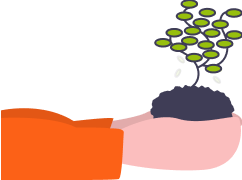
J’ai 5 minutes
Contribuez directement à nos actions de solidarité internationale grâce à un don.
Je donne
J’ai plus de temps
S'engager au CCFD-Terre Solidaire, c'est agir pour un monde plus juste ! Devenez bénévole.
Je m'engage











