Irak : les marais mésopotamiens vont-ils disparaître ?
L’écosystème unique des marais du sud de l’Irak est aujourd’hui menacé : par le réchauffement climatique, mais aussi par les barrages régionaux construits en amont. Les populations locales subissent de plein fouet les dégradations de leur environnement. Reportage.
La petite silhouette baisse et lève son bras en un rythme régulier, ploie le buste en avant, coupe les roseaux brassée par brassée avec la machette et se relève. Sous ses pieds, la longue barque effilée bouge à peine. En quelques minutes, l’embarcation est pleine. Abbas, 12 ans, appuie fort sur sa longue perche et extirpe son bateau de la roselière [[Zone humide en bordure de marais.]]. Il va apporter sa récolte à sa mère. Les roseaux seront tressés pour fabriquer des nattes ou serviront de fourrage aux buffles d’eau. Le jeune garçon n’est pas allé à l’école, ne sait ni lire ni écrire, mais cela ne le perturbe guère.
Il ne voit pas sa vie ailleurs qu’ici, dans les marais. Sa famille, jusqu’au plus loin qu’on s’en souvienne, a toujours vécu sur l’eau, au milieu des roseaux. Abbas n’aime guère couper les roseaux. Il préfère pêcher. Son amie Tayyeba, 10 ans, n’aime pas davantage cette activité. « C’est difficile, on risque à tout moment de tomber dans l’eau », dit la fillette debout dans sa barque. Elle, son truc, c’est de s’occuper des buffles, placides comme d’énormes peluches.
Un écosystème unique au monde
Sans en être conscients, les deux enfants reproduisent le partage traditionnel des tâches dans la région. Aux femmes le bétail, aux hommes la pêche et la chasse. Ce garçonnet et cette fillette, par leurs mots, leurs gestes, leurs embarcations, renvoient le visiteur à des temps ancestraux et immobiles. Ils vivent dans le marais dit « central » du sud de l’Irak. Avec le marais de al-Hammar qui s’étend presque jusqu’à Bassorah et celui de Hawizeh, à cheval sur l’Irak et l’Iran, ils forment une vaste zone humide en pleine région désertique. Ce delta des fleuves Tigre et Euphrate constitue un écosystème unique au monde, à la valeur reconnue depuis des millénaires. C’est ici que se situait, dit-on, le Jardin d’Éden.
Leur occupation par l’homme est déjà attestée sur les bas-reliefs sumériens, vieux de 5 000 ans, découverts dans les villes royales de Erido, Uruk et Ur, en bordure des marais. Ils décrivent le même mode de vie que celui de Tayyeba et d’Abbas aujourd’hui : des villages lacustres, la pêche et la chasse, les longues embarcations transportant les fagots de roseaux. Les habitations elles-mêmes sont construites sur le modèle de celles des anciens Mésopotamiens.
Sur une minuscule île flottante, dans le marais de al-Hammar, voici celle d’Ashira al-Baher, 32 ans, sept enfants. Une pièce d’une quarantaine de mètres carrés : les murs et le toit sont en roseaux tressés serrés et le sol est recouvert de paille. Ashira est assise près d’un âtre en grosses pierres qui garde la théière au chaud et procure une vague chaleur en cette période hivernale. Derrière elle, des ustensiles de cuisine, un grand fait tout noirci, une louche, des assiettes. La famille vit dans cette seule pièce, vite enfumée et froide malgré l’épaisseur des murs en roseaux. On y mange, on y parle, on y dort, parents et enfants, enveloppés dans ces couvertures en synthétique très colorées que l’on trouve partout au Moyen-Orient. Le four à pain est à l’extérieur, large cylindre en argile ouvert sur le dessus. On plaque les galettes sur les parois pour les faire cuire. Pas d’électricité, bien sûr. Ni de sanitaires.

Les buffles ont leur enclos juste derrière la maison. Les petits sont dans la partie couverte. Dans l’autre, fermée sur les côtés par des parois de roseaux tressés, un gros mâle est attaché à un piquet. Les autres buffles adultes vaquent dans les marais toute la journée à la recherche de leur nourriture. Les buffles sont à la fois capital et source de revenus quotidiens. Dans le marais central, Ali, la trentaine, possède avec ses frères un nombre important de têtes de bétail. Nous ne connaîtrons pas précisément leur nombre, donner un chiffre précis pourrait attirer le mauvais œil. Un mâle reproducteur rapporte 50 000 dinars (37 euros) par saillie. Son prix est indexé sur le niveau de l’eau, indispensable à sa survie : 700 euros en période de basses eaux, près de 3 000 quand le marais est haut. Les femelles ne sont jamais vendues, trop précieuses par leurs veaux, et leur lait qu’Ali va vendre à Chibaich, la principale ville.
Chaque matin, il embarque de gros bidons bleus dans sa chakhtoura, la longue barque effilée équipée d’un moteur et va les livrer aux crémiers de la bourgade. Ceux-ci en feront du beurre, de la crème et un fromage qui ressemble à la mozzarella, en un peu plus acide. « Les cinq litres nous sont payés 4 000 dinars (3 euros), et nous en vendons 2 500 litres chaque jour. Juste assez pour acheter l’essentiel pour nous et pour le bétail », peste Ali. Et d’épeler : « légumes, riz, poulet parfois, fourrage et eau ». Fourrage et eau ? Alors que depuis chez Ali, on ne voit que roseaux et eau. À perte de vue. Et pourtant, en saison sèche, comme Ali, les « Arabes des marais », doivent de plus en plus souvent acheter de l’eau, pour eux et pour leurs buffles.
En 2018, l’Irak a connu sa pire sécheresse depuis 1931. Les trois marais qui forment le delta du Tigre et de l’Euphrate ont rétréci comme peau de chagrin. Là où il y avait plusieurs mètres de profondeur, il n’est resté que 30 cm d’eau. À d’autres endroits, elle a complètement disparu sur des hectares entiers. La pluie est finalement tombée fin octobre. « Mais elle est de mauvaise qualité. C’est de l’eau de pluie, pas l’eau du Tigre et de l’Euphrate. Elle manque de nutriments, les poissons ne grossissent pas », déplore un pêcheur venu, comme chaque matin, vendre ses prises aux vendeuses du marché de Chibaich.

L’eau salée est remontée à l’intérieur du Delta
Ashira al-Baher a perdu trois buffles à cause de la sécheresse. Les buffles meurent aussi à cause de la salinité de l’eau quand le niveau est très bas, et les populations tombent malades en la buvant. On dénombre pas moins de 100 000 personnes touchées dans la région de Bassorah [[Selon les données de « Save the Tigris », des échantillons montrent que le taux de salinité est 20 fois supérieur à celui recommandé par les autorités sanitaires irakiennes.]]. « Quand le débit des fleuves Euphrate et Tigre est trop faible, les eaux salées du golfe Persique remontent par le Chatt el-Arab, le principal chenal du delta, explique Salman Khairallah, un des fondateurs de Humat Dijlah, branche irakienne de la campagne internationale « Save the Tigris ».
Or, selon le ministère des Ressources hydriques, de 2008 à 2015, le débit des deux fleuves de 25 mètres cubes par seconde était insuffisant. Les trois dernières années, 2016, 2017 et 2018, l’eau salée est remontée de 80 km à l’intérieur du delta. Conséquence pour Ashira, l’éleveuse de buffles : « on a dû acheter de l’eau en 2018, comme en 2015. Il faut plusieurs tonnes par jour et la tonne coûte 12 000 dinars (8,90 euros). Je ne sais pas ce que nous allons devenir si ça continue », s’inquiète-t-elle. « Nous partirons dans une région des marais où il y aura encore de l’eau, ou nous vendrons nos buffles… pour nous acheter de l’eau », plaisante son mari en grimaçant.
La pluie a manqué, dans la région comme en amont du Tigre et de l’Euphrate, sur les hauteurs de Turquie et en Iran. Les scientifiques comme Salman Khairallah évoquent bien sûr un effet possible du changement climatique. Mais les habitants des marais accusent les barrages construits en amont des fleuves et de leurs affluents, en Turquie et en Iran. « Quand la Turquie a commencé à retenir l’eau, le niveau a baissé ici, affirme posément cheikh Loubnan al-Khayoun. Le problème, c’est que le partage de l’eau n’est pas régulé. Il faut que la communauté internationale fasse pression sur les pays voisins, la Turquie et l’Iran, pour qu’il y ait un accord équitable. »
Autorité morale, cheikh Loubnan reçoit chaque matin les doléances de ses concitoyens dans son moudhif de Chibaich, grande maison d’hôtes traditionnelle construite en roseaux tressés serrés. En forme de carène de bateau renversée, la structure du moudhif compte 11, 13 ou 15 arcs, selon le prestige de la tribu hôtesse. Il est orienté Nord-Est/Sud-Ouest « comme aux temps des Sumériens », souligne le cheikh. L’intérieur est nu, à l’exception de tapis, de coussins sur les côtés, d’une table basse avec le nécessaire à café et, sur le mur du fond, d’images pieuses d’Ali et Hussein, figures sacrées du chiisme. « Si nous obtenons un accord avec la Turquie, le grand barrage d’Ilisu ne sera pas un problème, car la Turquie relâchera l’eau quand nous en aurons besoin. Mais notre gouvernement n’agit pas », reprend-il, évoquant l’immense ouvrage sur le Tigre construit par Ankara en Anatolie du Sud-Est et en voie de remplissage. Avec un lac de retenue d’une capacité de 10 milliards de mètres cubes, le barrage risque de priver l’Irak d’une bonne partie des eaux du Tigre.

L’Iran, lui aussi, retient l’eau au profit de son agriculture. « Le peu qu’il relâche a nettoyé ses sols du sel et de la pollution aux engrais et aux pesticides, qui s’ajoute à celle qui provient de l’agriculture et des villes irakiennes, en amont du Tigre et de l’Euphrate, s’indigne Salman Khairallah. Les gouvernorats en amont des marais, en Irak même, pompent trop d’eau et les agglomérations, les usines, les centres médicaux, rejettent les eaux usées sans traitement. »
Des décennies d’histoire chaotique – l’embargo après la deuxième guerre du Golfe en 1991, l’intervention américaine en 2003, la guerre civile qui s’en est suivie – ont empêché tout renouvellement et tout développement des infrastructures. « Nous sommes très inquiets, avoue le cheikh Loubnan en enroulant autour de lui son grand manteau marron. Vous savez, les habitants des marais, nous sommes comme les poissons : nous ne pouvons vivre sans eau ! »
Dans un autre moudhif de Chibaich, un Sayyid, titre donné aux descendants du Prophète Mohammed, reconnaît son impuissance malgré son autorité religieuse : « Nous essayons de faire pression sur les autorités, sans effet jusqu’à présent. Nous espérions qu’avec la classification des marais sur la liste du patrimoine de l’Unesco, en 2016, des mesures seraient prises pour les protéger. Il n’en est rien, et beaucoup de gens, ici, s’attendent à devoir partir. » Ce ne serait pas le premier déplacement forcé de population, et il raviverait les souvenirs douloureux de l’époque de Saddam Hussein. Mais la mort des marais du sud, aujourd’hui, ne serait pas seulement la triste fin de la « fiancée de l’Irak ». Elle serait aussi celle d’un écosystème indispensable au Moyen-Orient tout entier. Les conséquences, à ce jour, n’en sont pas mesurables.
Faim et Développement est disponible sur abonnement payant. Nous vous avons offert cet article pour découvrir les contenus de notre magazine.


J'ai 1 minute
Partagez et relayez nos informations et nos combats. S’informer, c’est déjà agir.
Je m'informe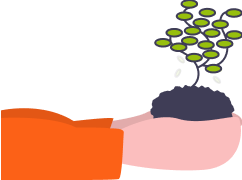
J’ai 5 minutes
Contribuez directement à nos actions de solidarité internationale grâce à un don.
Je donne
J’ai plus de temps
S'engager au CCFD-Terre Solidaire, c'est agir pour un monde plus juste ! Devenez bénévole.
Je m'engage











