Israël
Nous réconcilier avec nous-mêmes
Pour toute une génération d’Israéliens, ce qui se passe dans les Territoires occupés n’est pas un mystère. Lors d’un service militaire de trois ans (deux ans pour les filles), plusieurs dizaines de milliers de jeunes soldats sont confrontés quotidiennement à la population civile palestinienne : aux checkpoints, en patrouille sur les routes et dans les zones habitées…
Comme beaucoup d’autres, Yehuda Shaul est passé par là, de 2001 à 2004, au plus fort de l’Intifada. Il fut affecté à Hébron pendant quatorze mois, l’un des points les plus chauds de Cisjordanie avec, en plein cœur de la ville, quelques centaines de colons extrémistes.
Une part de tenèbres
La barbe imposante, le ton posé, la carrure tout en rondeurs, ce jeune homme de vingt-trois ans à la silhouette de roc a ressenti pourtant un immense vertige quelques mois avant sa démobilisation. « J’ai eu soudain une révélation : à quoi avons-nous pris part ? Qu’a-t-on fait de nous ? J’ai réalisé que nous agissions comme des monstres, que cette situation tirait de notre âme une part de ténèbres. Ceux qui étaient avec moi éprouvaient le même malaise. »
Depuis quelques années, les plages du sud de l’Inde voient déferler des centaines de jeunes Israéliens venus anesthésier leurs souvenirs militaires, à coup de substances illicites et de musique techno-trance. Un véritable phénomène de société. « C’est presque un rituel, grince Yehuda, on fait le sale boulot dans l’armée, on va se droguer en Inde et on rentre pour devenir un bon père de famille et un citoyen modèle ! »
Pas vraiment son style. Élevé dans le respect orthodoxe du judaïsme et le sens du devoir, il a estimé qu’il ne pouvait pas tirer un trait et qu’il devait témoigner. « Ce que nous vivons comme soldat est difficile à communiquer au retour. Comme si on nous disait “Faites notre m… dans les Territoires, mais ne la ramenez pas à la maison !” Alors je me suis dit qu’il fallait ramener Hébron à Tel Aviv ».
Briser le silence
Revenu à la vie civile, avec d’autres jeunes de son unité, il fonde une association qu’ils appellent « Briser le silence ». Ils réunissent quelques photos prises pendant leur service, et les exposent à Tel Aviv fin 2004. Couverture médiatique considérable. Pendant cinq mois, l’exposition tourne en Israël, y compris à la Knesset. Depuis, ils ont recueilli trois cent cinquante témoignages d’anciens soldats. « Nous faisons le travail que les journalistes israéliens ne font pas ! » Ils organisent à présent des visites à Hébron pour raconter in situ ce qu’est la réalité d’une armée d’occupation.
« Notre message est en deux temps. D’abord, il s’agit de regarder en face ce que nous sommes devenus. Tout le monde est persuadé de n’avoir fait que ce qui était nécessaire. Que les excès se limitent à des cas individuels. Certains croient sincèrement avoir essayé de se comporter humainement avec les Palestiniens. Mais la violence est un tout. Le problème commence dès que l’on donne à un jeune de dix-huit ans du pouvoir sur une population. »
Les recueils de témoignages publiés par Briser le silence fourmillent d’exemples de cette violence ordinaire. Écraser une voiture avec un char simplement parce qu’elle est mal garée, lancer sans motif une grenade dans un magasin la nuit, utiliser son pouvoir sur un checkpoint pour jouer avec les gens, poser pour la photo, triomphal, sur le cadavre d’un Palestinien, faire en sorte qu’un enfant monte sur un véhicule militaire pour l’abattre…
Comme un jeu vidéo
Face aux Palestiniens qui sont l’ennemi, toute sensibilité devient hors de propos. Yehuda se souvient de son premier jour à Hébron : « Je devais riposter à des tirs au lance-grenade au milieu des habitations. On tire à deux kilomètres, au jugé. J’étais tétanisé à l’idée que je pouvais tuer des civils. À la longue, c’est devenu comme un jeu vidéo. Quand on est soldat, poursuit-il, il y a toujours une justification à tout : il faut montrer que l’armée est là, il faut dissuader, il faut punir… Notre conscience est protégée par un mur de silence. On ne voit plus la limite entre le blanc et le noir. Tout est gris. C’est un processus de corruption morale. Il nous faut retrouver le sens de la limite. »
Mais le message de Briser le silence s’adresse aussi à la société israélienne. « L’armée est une arme entre les mains de la société. Nous ne tirons pas de conclusion politique des témoignages que nous recueillons. Mais quelles que soient les décisions des Israéliens, ils doivent le faire en connaissant le prix qu’il faut payer !
J’ai compris que les checkpoints ne sont pas seulement là pour empêcher les Palestiniens de circuler. Ils servent aussi à empêcher la réalité d’entrer en Israël. Quand on écrira l’histoire de l’Intifada, notre travail interdira de faire comme si l’on ne savait pas. La séparation n’effacera pas ce que nous avons fait, conclut Yehuda. Mais il nous faut d’abord nous réconcilier avec nous-mêmes. »
La Nakba en hébreu
Eitan Bronstein estime nécessaire d’éclairer une autre zone d’ombre de la conscience collective. En 1948, durant la guerre qui a accompagné la création de l’État d’Israël, les habitants de quatre cents villages palestiniens ont été expulsés. Les villages ont ensuite été détruits et ont disparu du paysage israélien. Un événement fondateur pour la conscience palestinienne, désignée comme la « catastrophe », la Nakba.
Le problème des réfugiés continue de hanter les cauchemars des Israéliens qui craignent de se voir chassés de la région, si les descendants des expulsés de 1948 revenaient sur leurs terres d’origine. Cet épisode, tout comme la question de la responsabilité israélienne dans le drame des réfugiés, sont enfouis sous une chape d’oubli et de déni.
Or, c’est l’un des enjeux cruciaux d’une négociation de paix. Même si pour les Palestiniens, la reconnaissance du droit au retour vaut au moins autant que le retour lui-même. Difficile d’aborder cette question en Israël, où l’histoire officielle s’en tient encore plus ou moins à l’idée que les pays arabes en guerre contre le nouvel État portent seuls la responsabilité de l’exode des Palestiniens en 1948. Une vision très largement démentie par les travaux des historiens.
Nettoyage ethnique
« L’État juif n’aurait pas pu exister sans violence, affirme Eitan Bronstein. Le plan de partage de 1947 n’était pas compatible avec ce que souhaitaient les dirigeants israéliens, parce que la majorité démographique juive n’était pas garantie au sein du territoire alloué à Israël. Ben Gourion voulait un État juif, le transfert des populations palestiniennes était donc inévitable. »
Et de poursuivre, « ce que nous avons fait, c’est un nettoyage ethnique. En refusant de nous réconcilier avec cette partie de notre Histoire, en continuant à nier notre responsabilité, nous continuons à faire du mal aux Palestiniens. On ne peut pas refaire l’Histoire. L’essentiel maintenant c’est la reconnaissance. C’est la clé de 90 % du problème. »
En 2002, il crée une association baptisée Zochrot, une subtilité de langage intraduisible pour dire « Se souvenir » au féminin, dont il définit ainsi l’objectif : « Élaborer un récit de cette période qui fasse sens dans l’Histoire juive, pour qu’elle ait une place dans la mémoire d’Israël. Écrire la Nakba en hébreu ».
De manière emblématique, Zochrot pose régulièrement des panneaux indicateurs pour signaler l’emplacement des anciens villages palestiniens. Et bien que la plupart du temps, ces lieux soient aujourd’hui déserts, les panneaux sont rapidement arrachés. Un signe du rejet violent de cette mémoire dans l’opinion israélienne. Comme Yehuda Shaul, Eitan Bronstein voit dans l’examen du passé, la clé d’un avenir commun avec les Palestiniens.
Thierry Brésillon
Ceux qui vivent ensemble
Quelques jours après le début de l’Intifada va naître une initiative exemplaire : Ta’ayush, « Vivre ensemble » en arabe. Un groupement d’Israéliens et de Palestiniens décidés à démontrer qu’ils peuvent agir côte à côte.
David Shulman, professeur à l’Université hébraïque de Jérusalem, spécialiste du sanscrit, s’est engagé dans cette aventure depuis 2002. Persuadé qu’il n’y a que des gagnants dans la paix, mal à l’aise avec « l’égoïsme borné et autosatisfait du nationalisme moderne » qui a cours en Israël, il se sent « responsable des atrocités commises en [son] nom par la moitié israélienne de l’histoire ».
Dans Journal d’un combat pour la paix, il raconte l’action au quotidien de Ta’ayush. Solidaires des paysans victimes des violences commises par les colons extrémistes, les militants de Ta’ayush sont confrontés à des policiers ou à des militaires pas toujours très à l’aise dans un rôle ambigu : protéger des agresseurs, arrêter des manifestants qui viennent seulement aider des Palestiniens à récolter leurs champs ou apporter des couvertures à des familles jetées dehors par les démolitions de leurs habitations…
Un récit vivant, nuancé, poétique. Un souffle d’espoir dans un contexte assez désespérant.
Ta’ayush, journal d’un combat pour la paix. David Shulman, Le Seuil, 270 pages, 20 euros.


J'ai 1 minute
Partagez et relayez nos informations et nos combats. S’informer, c’est déjà agir.
Je m'informe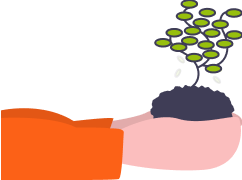
J’ai 5 minutes
Contribuez directement à nos actions de solidarité internationale grâce à un don.
Je donne
J’ai plus de temps
S'engager au CCFD-Terre Solidaire, c'est agir pour un monde plus juste ! Devenez bénévole.
Je m'engage











