Cerner le phénomène
Parmi les conséquences néfastes de la crise financière globale, il en est une qui inquiète particulièrement : la montée en puissance du secteur privé comme instrument de coopération. Les États, aux ressources publiques de plus en plus exsangues, et peu disposés à en engager pour la coopération, gèlent leur participation ou se dégagent des politiques publiques internationales de développement. Ils en appellent notamment au secteur privé pour s’intégrer dans leurs plans d’actions : que ce soit dans les politiques nationales ou dans les sommets régionaux et internationaux (Rio+20 mais aussi le Forum Mondial de l’Eau, le G8, le G20, l’Union Européenne ,…), le secteur privé s’impose aux côtés des États qui s’adressent de plus en plus à lui afin de trouver les ressources nécessaires pour tenir leurs engagements en matière d’aide au développement dans les pays du Sud. Les organisations internationales connaissent les mêmes difficultés et peinent à répondre aux situations de crise. Le Programme Alimentaire Mondial et l’Agence des Nations Unies pour l’Agriculture et l’Alimentation (FAO) ont ainsi dû réitérer leurs appels d’urgence par manque de financement pour répondre à la crise alimentaire dans la Corne de l’Afrique et dans le Sahel.De fait, l’inclusion du secteur et des investissements privés dans les politiques publiques constitue un effet d’aubaine en permettant notamment aux entreprises des pays du Nord et émergents d’avoir accès aux marchés et aux ressources encore partiellement exploités et insuffisamment régulés des pays du Sud… sans avoir à assumer ni les objectifs ni les exigences de réelles politiques publiques en la matière.
Le lancement de nouvelles dynamiques internationales, si louable en soit l’objectif annoncé, peut aboutir à des mesures totalement contre-productives, et accoucher de « fausses solutions ». Le précédent des agrocarburants devrait nous le rappeler : sous l’objectif vertueux de développer des énergies alternatives aux ressources fossiles, l’incorporation d’éthanol et de diesel végétal dans les carburants s’est traduit par une ruée sur les terres et les productions agricoles et une flambée sans précédent des prix alimentaires dans les pays du Sud. Tout cela pour une réduction des émissions de gaz à effet de serre largement remise en cause. La raison ? À vouloir ménager la chèvre et le choux, c’est au final le loup qui a le dessus : les pays les plus riches ou émergents, tout en prônant la coopération et la solidarité, veulent à tout prix poursuivre leur propre croissance. Ils ont besoin pour cela d’accéder aux ressources naturelles qui leur manquent : c’est donc avant tout la libéralisation des échanges et la croissance de leurs propres investissements qu’ils encouragent, même dans le cadre des politiques de coopération.
Ces investissements sont ainsi souvent liés à l’accès aux terres et aux ressources des pays destinataires, s’apparentant trop souvent à un accaparement de ces ressources. Il est désormais bien connu que de tels investissements peuvent avoir des impacts négatifs sur l’environnement et les populations locales. Ils continuent cependant d’être promus dans toutes les instances internationales et nationales, sans être assortis des conditions nécessaires. Sur ce point, le Sommet de la Terre qui se tient à Rio du 20 au 22 juin 2012 ne fait pas exception.
À qui profitent réellement ces investissements ? Quel coût humain, social et environnemental représentent les accaparements de terres et de ressources qui y sont liés ?
L’objectif des États réunis aux Sommets de la Terre est-il bien de préserver notre planète, ses ressources, et un développement durable pour tous, ou de se faire les représentants de commerce de leurs entreprises ?
Définition et chiffre
Si la problématique n’est pas nouvelle, les accaparements de terres et de ressources se sont considérablement accrus ces dernières années et atteignent des niveaux inquiétants. Aujourd’hui, relever le défi environnemental soulève de nombreux enjeux connexes, dont l’un est fondamental : celui d’une gestion des terres et des ressources naturelles. Cependant, la volonté de développer des modèles durables de gestion de ces ressources, tout en répondant aux besoins fondamentaux de l’humanité, se confronte à des intérêts contradictoires : ainsi le défi alimentaire – nourrir 9 milliards d’humains en 2050 – s’oppose au défi énergétique, qui comporte le développement d’énergies dites alternatives (comme les agrocarburants à base de matière première agricole)… Ce même défi alimentaire est confronté à l’urbanisation croissante et à la volonté de développer des infrastructures pour les bâtiments, les transports, l’électrification… L’un comme l’autre défi reposent sur l’accès à des terres et des ressources (eau, forêts, sous-sols..). Dans la poursuite de l’objectif prioritaire qu’ils se sont fixés, les acteurs cherchent donc à s’approprier ces ressources.
Les accaparements de terres et de ressources : la définition du CCFD-Terre Solidaire
Si l’on s’accorde sur l’existence d’une dynamique d’accaparement de terres à l’échelle mondiale, la terminologie permettant de rendre compte de la nature et de l’ampleur du phénomène est différente selon les acteurs. Ainsi, le terme accaparement des terres est principalement utilisé par les ONG et les médias dans l’intention d’utiliser des mots forts afin de frapper l’imagination. Plusieurs expressions ont également une grande portée symbolique, comme « la ruée vers les terres » ou « le grand monopoly » (des acquisitions de terres). D’autres expressions à forte connotation négative sont également utilisées – telles que transaction foncière illégitime, spoliation, confiscations massives – et mettent en avant le caractère (supposé) illégal voire usurpatoire de ces pratiques.
Au contraire, d’autres acteurs, comme les institutions internationales, se veulent plus neutres dans leurs discours afin de ne pas prendre parti ou exprimer un jugement de valeur. Elles utilisent ainsi de préférence les termes techniques faisant référence aux formes de contractualisation de la terre (acquisition, transaction, concession) ou à l’action sous-jacente supposée, à savoir, les investissements. Du côté des acteurs académiques, les travaux déjà produits sur ce thème sont peu nombreux et disparates, révélant, si ce n’est un manque d’intérêt, du moins un manque de discussion et de recul sur le sujet. Quant à l’implication des médias dans le débat, elle est relativement modérée (le sujet étant couvert par un nombre limité de journalistes généralement spécialistes des questions de développement). Le terme choisi pour définir le sujet dépend alors de l’implication des journalistes, de leur volonté d’orienter le lecteur ou encore du degré de liberté dont ils disposent.
Une récente présentation de la FAO en amont de la dernière Conférence Régionale d’Amérique Latine qui reprenait plusieurs études sur le phénomène soulignait ainsi que les accaparements étaient un phénomène nouveau et limité à deux pays, l’Argentine et le Brésil. D’autres analyses se limitent aux accaparements de terres dits « de grande échelle ». Ainsi chacune de ces définitions réduit le champ d’analyse.
Pour le CCFD-Terre Solidaire, l’accaparement des terres concerne la prise de contrôle d’un territoire (par achat, location, occupation,…), qu’elle soit légale ou non, qui entraînent des incidences négatives sur les communautés locales ou les usagers originaux du terrain, c’est-à-dire lorsque les transactions foncières affectent directement ou indirectement le modèle économique, sociétal, social ou environnemental des communautés locales et portent donc atteinte aux droits inscrits dans la Charte internationale des droits de l’Homme. Les conflits d’intérêt qui accompagnent cette pratique sont autant de signes qu’il existe un rapport de force inégal entre investisseurs, gouvernements et communautés locales. La question de l’inégalité est aggravée par la faiblesse des mécanismes d’accès et de recours à la justice par les communautés locales affectées.
Cette définition des accaparements de terres s’appuie principalement sur l’existence d’impacts négatifs (sur les communautés locales, les droits humains, l’environnement), sur les pratiques des acteurs (rapport de force inégal, absence d’information, de transparence, de concertation, etc.) et sur les absences / lacunes des cadres normatifs (tableau 1). Toutes ces caractéristiques sont considérées comme « centrales », les autres caractéristiques (montants investis, nombre et nature des transactions, origines des investisseurs, etc.) sont dites « périphériques ».
Outre son exhaustivité, cette définition permet d’éviter les écueils liés aux caractéristiques fréquemment utilisées pour désigner les accaparements de terres, qui révèlent leurs limites.
Les déterminants généralement utilisés pour désigner les accaparements de terres et de ressources
Si les caractéristiques retenues pour définir le phénomène d’accaparements de terres et de ressources sont différents selon les acteurs, certaines prédominent : la superficie de terres concernée, le montant et la finalité des investissements, et les types d’acteurs impliqués. Mais au vu des exemples connus et des pratiques constatées ces dernières années, aucun de ces éléments ne semble totalement pertinent pour appuyer une analyse et proposer une définition. En effet, bien que la taille du terrain accaparé soit souvent citée, cette approche est trop relative et pose la question du seuil à considérer (lequel bien entendu varie selon les contextes, la taille du pays, etc.). Aussi plutôt que la taille des terrains concernés, il paraît plus pertinent de considérer s’il y a concentration de terre dans les mains d’un nombre restreint de personnes, ou de prendre en compte la valeur sociale, environnementale et « alimentaire » des terrains appropriés.
Concernant le montant des opérations, la notion est aussi relative. À partir de quelle somme peut-on considérer qu’il y a un investissement massif sur un territoire ? Seuls “les principes de l’Equateur” traitent du montant des investissements, toutefois ils ne considèrent le phénomène que sous l’angle des grands projets tels que la construction d’infrastructures, de barrages, d’industries extractives dont le montant d’ investissement dépasse les 10 millions d’USD. Or, dans de nombreuses situations, les accaparements se font finalement pour des montants dérisoires voir quasi symboliques. Le volume financier des opérations ne peut donc pas non plus être considéré comme la caractéristique centrale pour définir le phénomène.
L’objectif final de l’investissement pose également problème. S’il existe une prédominance notable des accaparements de terres et de ressources en lien avec une production de matières premières agricoles – monocultures d’huile de palme, de soja, de canne à sucre, de blé etc. – des négociations foncières dans d’autres secteurs d’activités (tels que le secteur extractif, l’installation d’une usine et même le tourisme) ont les mêmes incidences négatives sur les communautés locales.
Enfin, sur la nature des acteurs, les plus anciennes définitions d’accaparements de terres sont centrées sur les investissements fonciers réalisés par les acteurs étrangers tels que les multinationales, les banques, les assurances ou encore les États via leurs fonds d’investissement. Cependant, cette analyse ignore largement le jeu des intermédiaires. Des études plus récentes soulignent l’importance des projets engagés par des entreprises nationales ou des élites locales qui engendrent aussi d’importantes « externalités négatives » (impacts) sur les communautés locales. La nationalité de l’acteur responsable d’accaparements ne peut donc pas être considérée comme un critère d’analyse (d’autant plus que la mondialisation économique et les multiples connexions et relations d’influence entre investisseurs de tous horizons participent à la dilution de l’identité des acteurs économiques).
Au-delà des débats sur la terminologie utilisée pour décrire le phénomène et le choix des caractéristiques, le chiffrage même des accaparements de terres fait débat.
Quelques chiffres clés et tendances
De nombreux acteurs (Organisations Internationales comme la Banque Mondiale, la FAO, ou des ONGs) ont essayé de quantifier l’ensemble des transactions foncières mais les référentiels d’analyse sont trop différents et ne permettent pas une comparaison. L’estimation la plus élevée considère qu’entre 2000 et 2011, au moins 203 millions d’hectares ont fait l’objet de négociations (achevées ou en cours), soit la moitié du territoire de l’Union Européenne !
Mais, tout comme l’ampleur de la surface accaparée ne constitue pas une caractéristique centrale pour l’analyse du phénomène, les chiffres annoncés ne permettent pas de cerner pleinement l’ampleur réelle (et donc les effets concrets) du phénomène. De plus, nombre de transactions ne sont pas signalées ou rendues publiques et chaque jour la liste s’allonge. Les chiffres annoncés sont ainsi sans aucun doute largement sous-estimés. Dans l’optique de considérer les accaparements de terres et leurs impacts dans la perspective des droits humains et de l’environnement, il serait intéressant de modifier la méthodologie de calcul et sa présentation en mettant en lien l’acquisition de terres avec les impacts négatifs qui en découlent pour les populations locales.
Les différentes analyses font état tout de même d’un certain nombre de tendances dans l’évolution du phénomène :
• la demande en terres (et donc la pression au niveau mondial) reste importante et va continuer de s’accroître à long terme, favorisée par des tensions constantes sur les marchés de matières premières, l’augmentation de la production et de la consommation d’agrocarburants et la raréfaction des terres et ressources.
• cette ruée vers les terres est non seulement liée à la production de nourriture, et concerne donc les terres cultivées et cultivables, mais également à l’extraction de matières premières. Ainsi, si 78 % des accaparements recensés par l’ILC concernent la production agricole (dont les trois quarts destinés aux agrocarburants), le secteur extractif, industriel, touristique et les conversions forestières prennent aussi une part significative (22 % des investissements).
• l’Afrique est principalement concernée par les accaparements de terres. On estime à 134 millions d’hectares la surface ayant fait l’objet de transaction en Afrique entre 2000 et 2010 (soit l’équivalent du Tchad, deuxième plus grand pays d’Afrique sub-saharienne). Le continent asiatique est le deuxième le plus touché avec 22 millions d’hectares.
Le « grenier » du Mali menacé par des investissements
La région de l’office du Niger se situe au centre du Mali et constitue le « grenier » du pays. Sur ces terres, où se pratiquent l’élevage et le maraîchage, 90 000 hectares de terres irriguées étaient jusqu’alors réparties entre 50 000 exploitants qui assuraient à eux seuls 60% des besoins en riz du pays. Mais ces dernières années, des accords portant sur plusieurs centaines de milliers d’hectares de terres agricoles de la région ont été signés entre le gouvernement malien et des investisseurs privés ou publics.
Ainsi, des travaux d’élargissement d’un canal d’irrigation de 40 kms de long, et la construction d’une route, sont prévus dans le cadre du projet Malibya porté par une société libyenne sur une surface de 100 000 hectares (production envisagée : riz, produits maraîchers, maïs, bétail, pour exportation vers la Libye). Alors que les travaux n’ont pas encore abouti, les habitants de la région sont déjà mécontents d’avoir vu leurs habitations démolies et d’avoir été très mal dédommagés. En outre, les maraîchers de la zone se plaignent d’une pénurie d’eau consécutive aux travaux. En effet, un investissement d’une telle ampleur ne prend pas seulement la terre, mais aussi l’eau, la forêt, la biodiversité, la faune, la flore : accaparer des terres, c’est accaparer tout un écosystème ! Le contrat signé avec l’État malien assure au projet Malibya un accès prioritaire à l’eau durant la saison sèche.
Dans un autre domaine, l’expansion du périmètre sucrier via un partenariat public-privé entre l’État malien et la société sucrière Markala menace une trentaine de villages, provoquant inquiétude et colère parmi les habitants : ils s’interrogent sur le devenir de leur sécurité alimentaire et sur l’intérêt pour eux de la transformation de champs qui, depuis des générations, servaient à nourrir une grande partie du pays. Aujourd’hui tout est remplacé par de la canne à sucre servant à la fabrication d’agrocarburants !
Ces grands investissements ont des conséquences dramatiques sur les communautés paysannes : la plupart de ces projets provoquent des déplacements de population, réinstallées sur des terres marginales et plus pauvres. Cela entraîne la paupérisation de la communauté, incapable de compenser la perte d’autosuffisance alimentaire par des revenus suffisamment stables.
À ce triste recensement, il faut ajouter la privatisation des terres du village de Sanamadougou. Fort de ses connivences avec les plus hautes sphères de l’État, un homme d’affaires malien a depuis 2009 fait intervenir l’armée à plusieurs reprises. Des maisons ont été rasées et des dizaines de personnes emprisonnées. Les villageois rapportent que depuis le début du conflit, trois personnes seraient décédées et une femme aurait fait une fausse couche du fait des violences subies.
Mais les habitants du village de Sanamadougou ne se résignent pas. En novembre 2011 ils participaient à la conférence paysanne internationale organisée à Nyéléni sous l’égide de la Via Campesina, aux côtés de représentants d’organisations paysannes et d’ONG venus des quatre coins du monde ou des villages en conflits de l’Office du Niger. Dans leur résolution finale, les organisations ont souhaité rappeler que « la lutte contre les accaparements de terres est un combat contre le capitalisme et contre un modèle économique prédateur. Nos terres et nos identités ne sont pas à vendre ! ».
La convergence malienne contre les accaparements de terres, à laquelle participent des partenaires du CCFD-Terre Solidaire, a adressé le 18 mai 2012 une lettre ouverte au ministre de l’Agriculture, de la pêche et de l’élevage et ancien directeur de l’Office du Niger dénonçant la situation particulièrement difficile des villageois de Sanamadougou : « Les petits producteurs au Mali sont ceux qui ont investi dans les terres depuis des générations, et non les investisseurs qui viennent s’accaparer précisément ces terres. […] Aujourd’hui, c’est la survie de certains d’entre eux qui est menacée, surtout avec la ruée des investisseurs sur les terres agricoles pour l’agrobusiness ».
Pour comprendre et résister au phénomène de l’accaparement de terre il est nécessaire de répondre aux questions suivantes : quelles sont les pratiques les plus fréquentes qui permettent que les terres soient appropriées par un autre acteur que celui qui utilisait le terrain à l’origine ? Quels acteurs sont impliqués dans ce phénomène ? Quels enjeux se cachent derrière ce phénomène ?


J'ai 1 minute
Partagez et relayez nos informations et nos combats. S’informer, c’est déjà agir.
Je m'informe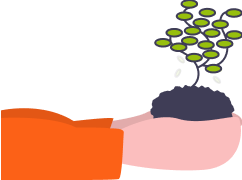
J’ai 5 minutes
Contribuez directement à nos actions de solidarité internationale grâce à un don.
Je donne
J’ai plus de temps
S'engager au CCFD-Terre Solidaire, c'est agir pour un monde plus juste ! Devenez bénévole.
Je m'engage











