En quête de l’igname jaune et du mil violet
Face aux aléas de toutes sortes, l’entretien et la valorisation des variétés locales par les paysans leur garantissent une bien meilleure sécurité alimentaire que le recours aux semences du marché. Reportage en Côte d’Ivoire et au Sénégal chez des collectifs ruraux, membres du réseau Copagen (Coalition pour la protection du patrimoine génétique).
La guerre civile, qui a déchiré la Côte d’Ivoire, entre 2010 et 2011, a provoqué la destruction de biens scientifiques inestimables, déplore Sébastino da Costa, chercheur en gestion de l’environnement à Abidjan. À Bingerville, San Pédro ou Bouaké, des stations agronomiques ont été envahies par des populations affamées qui ont pillé un patrimoine en végétal et animal inestimable. « Des variétés en cours d’amélioration depuis plus de trente ans – une catastrophe ! »
Le travail opiniâtre de Rose Digrah a failli connaître le même sort. Animatrice d’un collectif de soutien aux agricultrices, elle s’enthousiasme à la création du réseau Copagen. « J’ai pris conscience de l’enjeu de la préservation des variétés locales. Je suis devenue une chasseuse de semences ! » Dans son village de Tabléguikou, à l’ouest d’Abidjan, le maraîchage cède devant la poussée des cultures industrielles d’hévéa ou de palmiers à huile. « Piment, gombo, aubergine… Des variétés se perdent… »
En 2008, une femme âgée lui présente trois ignames jaunes. « Je n’en avais pas revu depuis mon enfance ! La variété était tenue pour disparue dans mon village. » Elle plante les tubercules, parvient à les multiplier… Et c’est la guerre : « Les gens ont tout mangé dans mes champs ! » Mais, Rose Digrah retrouve une poignée d’ignames jaunes quelques mois plus tard, et son projet de réintroduction redémarre, sous sa surveillance redoublée. À Aïdeko, village en lisière de forêt dans la région de Divo, la population a accepté de multiplier le tubercule. « Il a un goût précieux ! », sourit malicieusement Angèle Djegba. « Nous nous sommes donné trois ans pour décoller », indique Rose Digrah.
Au Sénégal, la catastrophe est venue du ciel, au début des années 1970 : une sécheresse historique, qui a cuit la plupart des récoltes. Arachide, mil, sorgho, fonio (céréale), niébé (haricot), « les semences ont presque toutes disparu », se souvient George Tine, de l’association Niul-Jama, près de la ville de Thiès. L’État met en branle un plan d’importation de semences et de distribution « qui a éradiqué les pratiques paysannes de conservation des variétés… »
Dans les années 1990, lassés d’être à la merci du « tout venant », les paysans lancent des inventaires de semences ainsi que des foires d’échange. Celle de Fandene attire jusqu’en Gambie. Et en 2010, un paysan montre à Georges Tine un petit sac de mil violet. « Une variété exceptionnelle, excellente, et que les oiseaux n’attaquent pas ! » À l’Association sénégalaise des producteurs de semences paysannes, on n’en revient pas : la variété était tenue pour disparue. Georges Tine en récupère deux kilos et multiplie la semence. Aujourd’hui, le mil violet commence à se répandre. La demande est forte.
Les maraîchères épatent les agronomes
À une cinquantaine de kilomètres au sud, à Keur Abdou Ndoye, un groupe de maraîchères de la Fédération des agropasteurs de Diender s’active sur de magnifiques parcelles de légumières cultivées en bio. Elles fréquentent la foire de Fandene pour récupérer des variétés traditionnelles appréciées mais devenues introuvables – concombre madar, tomate mboro, pomme de terre arambané –, supplantées par des légumes importés dont les semences, hybrides, doivent être rachetées tous les deux ans. « Alors que les nôtres sont réutilisables à volonté ! », s’exclame Meiya Ka.
Les femmes réapprennent les techniques d’amélioration des lignées de leurs parents : la sélection des plants les plus beaux et les plus résistants pour les laisser monter en graine, réserve pour les prochains semis. Aby Beye a épaté des agronomes en récoltant des semences de laitue borolé, variété locale réputée délicate. Les semencières débutantes en « bavent » encore. « J’ai trimé quatre mois pour… 1 500 FCFA de bénéfice[[Environ 2,30 euros.]] », souffle Awa Ndiagne.
En Côte d’Ivoire, le laminoir à uniformiser la diversité des cultures vient aussi de variétés introduites. « Ici, quand on veut vivre de sa production de riz, on passe invariablement au “Wita 9” », se désole Bernard Kouakou, président de l’association nationale des producteurs de semences, à Yamoussoukro. Dix tonnes à l’hectare : une productivité imbattable. Il aimerait se consacrer à des variétés locales très goûteuses mais rares, comme le danané. Peu productif (et donc cher), dépendant des pluies, on se l’arrache pourtant sur le marché. « Le problème, c’est que l’État, très présent sur la filière rizicole, stratégique, ne nous octroie pas l’appui technique nécessaire pour développer ces variétés », regrette Rose N’Guessan, de la coopérative Entente.
Au Sénégal, les déboires des grandes céréales affectent encore plus l’arachide, autre culture majeure. À la qualité aléatoire des semences du marché s’ajoute, dans les zones peu arrosées, le dérèglement de la saison des pluies : erratique, tardive, trop brève pour les arachides traditionnelles. Aussi, quand l’Institut sénégalais de recherche agronomique (Isra) met au point la « 5533 », une variété locale sélectionnée pour son cycle court, l’Union des groupements de producteurs de Méckhé (UGPM) décide, en 2010, de créer sa propre coopérative semencière. L’UGPM sélectionne les paysans les plus aptes à multiplier les semences de 5533. Ils s’engagent à vendre (à prix attractif) la majeure partie de leur production à l’Union qui approvisionne ses membres et accroît chaque année le nombre de ses producteurs de semence. « D’ici à cinq ans, nous ne dépendrons plus ni des pouvoirs publics ni du marché », pronostique Mbaye Diouf. C’est déjà le cas depuis des années pour les céréales.
Plus au nord, c’est le Sahel. Et c’est aussi grâce à la force de son collectif que la Fédération des associations paysannes de la région de Louga (Fapal) parvient à contrecarrer le marasme semencier des dernières décennies. Depuis 2008, elle organise la production de semences traditionnelles de souna (petit mil), de niébé (haricot) et d’arachide, les trois cultures prioritaires de la région. La Fapal pense être autosuffisante dans trois ans. Initiative déterminante : la création de magasins de stockage de semences dans chaque zone de groupements de producteurs.
Dans le village de Dioral, près de la ville de Fatick, les techniques de conservation ont également conditionné les progrès. Sous l’arbre de neem de la place, les femmes présentent leurs trésors familiaux : des semences traditionnelles de riz rouge sauvage, de sorgho, de niébé, de mil… Elles sont conservées dans les cases d’une année sur l’autre selon des techniques simples et efficaces – bidons remplis de feuilles de neem (anti-insectes), fumage au-dessus des foyers de cuisine, greniers d’argile, etc. « Et nous cheminons vers l’agroécologie », souligne fièrement Mamadou Diallo, président de l’Union des collectifs de Tattaguine.
Un rescapé de l’agrochimie converti au bio
Plus de semences du marché ni d’intrants synthétiques : c’est la ligne rigoureuse de l’efficace Fédération des producteurs de la région de Tambacounda, à l’est du Sénégal. Dans le village de Saré Samburu, Abderahmane Bâ est un rescapé de l’agrochimie. Autrefois salarié d’une entreprise cotonnière, il est tombé malade, intoxiqué au contact des stocks de pesticides. Depuis, il cultive le coton en bio. « Plus de dettes, la santé, un bon prix de vente : tous les gains sont pour nous ! » Créer une coopérative de semences ? La fédération n’en a pas les moyens. Cependant, dans cette région de l’est du Sénégal, les paysans ont maintenu la tradition de conserver des semences. Pour la soutenir, la fédération a renforcé son réseau de banques de céréales. « En approvisionnant les familles en difficulté lors de la soudure, nous réduisons le risque qu’ils mangent leurs réserves de semences », explique Amadou Souaré.
Et puis, il y a l’exemple des anciens. Ici, Mamadou Camara est une sorte de légende. Bravant les ricanements, le vieux paysan est le premier à avoir osé le coton bio, en 1994. Il est aussi devenu un spécialiste du maïs, dont il a sélectionné des variétés de grand intérêt. « Mon maïs rouge, je sais qu’il donne en soixante-dix jours exactement. J’en fais profiter mes voisins, mes collègues, les participants aux foires d’échanges de semences. » Et même les chercheurs de l’Isra, qui ont découvert auprès de lui, des variétés dont ils ignoraient l’existence.


J'ai 1 minute
Partagez et relayez nos informations et nos combats. S’informer, c’est déjà agir.
Je m'informe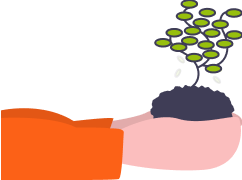
J’ai 5 minutes
Contribuez directement à nos actions de solidarité internationale grâce à un don.
Je donne
J’ai plus de temps
S'engager au CCFD-Terre Solidaire, c'est agir pour un monde plus juste ! Devenez bénévole.
Je m'engage











